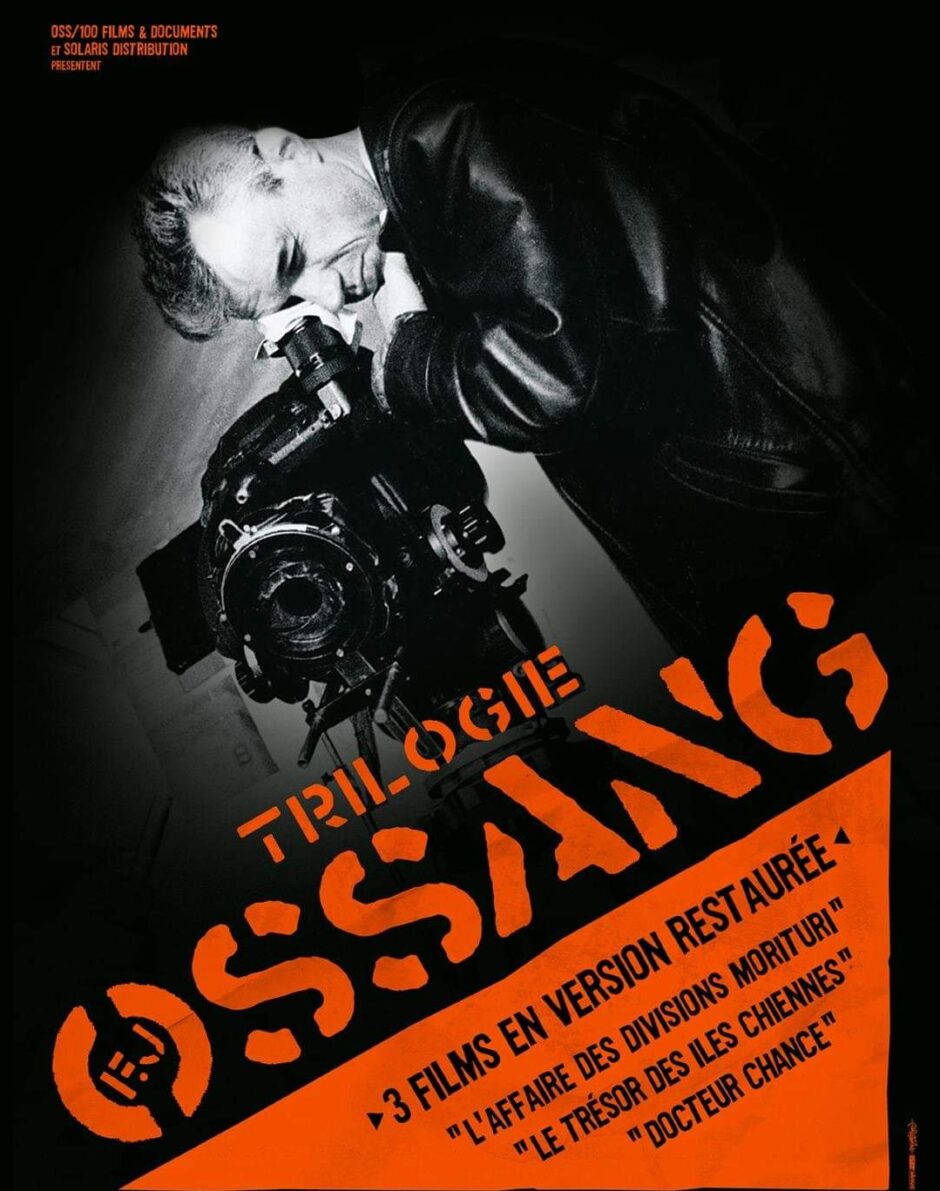F.J. Ossang
Légende pour une bibliothèque en feu
Une bibliothèque sert d’abord à rebrousser la mémoire d’une formation. Revenant au pays, parmi les ombrages d’une demeure extérieurement en désolation, je retrouve au bout de plusieurs jours les charmes d’un secret perdu pour toujours – tant d’aventures inachevées, des expériences mentales fortes – poussées à bout, le gravissement d’une ambition affrontée dés l’adolescence contre la solitude fatale : tout finit par suinter de la tapisserie odorant en retrait des volets clos, pour s’évanouir fugitivement dans une brume de sensation équivoque menant droit aux pièces du fond où s’entassent livres et papiers encore humides après l’hiver : la bibliothèque…
Ici l’on a trié des ouvrages de circonstance et de contondement, l’horizontal et le vertical se trouvant réunis dans l’abandon d’une actualité. Certains livres ont favorisé l’accession à une socialité littéraire de surface, quand d’autres ont permis de creuser plus avant, de faire effraction, d’ouvrir une brèche à l’expérience nécessaire — immédiate… mais tous ont connu la même relégation, dans l’ombre humide, l’oubli des saisons, la désaffection de telle Maison Jaune où cependant tout était advenu, en son temps, sauf que le temps a passé…
J’ai choisi d’instinct des mots durs comme rélégation, abandon, désaffection qui signalent d’abord les symptômes du temps éprouvé depuis ma jeunesse – c’est une époque où des oeuvres sortirent de la relégation quand d’autres ont connu l’abandon, cependant que d’autres encore couvraient toute l’étendue de la désaffection qui les avait fait naître – la désaffection ne sonne-t-elle pas la grande affaire de ces dernières années… Pourtant ces livres sont toujours là, conservés, remisés certes, mais jamais cédés, comme les originaux en vinyle de l’insurrection rock’n roll dont ils partagent l’écrin poussiéreux, mais point l’acuité…
Qu’une chanson s’élève dans le noir, c’est le feu des ans décisifs qui nous reprend et consûme comme au premier après-midi, la rage « d’en découdre avec le vide », tandis qu’une lecture distraite des anciens livres, loin d’éveiller les sentinelles sacrées, active simplement le fantôme des jours et des circonstances où l’on prit conscience d’un pouvoir, d’une autorité, d’une mode sévère à l’endroit des lettres modernes – ces livres caressent un sentiment, désignent l’attrait d’une désuétude, l’éclat poli du soleil sur les pierres bordant la rue tel petit matin où l’on entra chez le libraire, ou ressortit du cabinet d’un éditeur, conscient que ce monde toujours, nous serait interdit…
Curieusement ces ouvrages attisent en nous la bordure de souvenirs, et non le coeur, ils effleurent son étoffe au lieu de faire saillir l’éclair d’un couteau, le signal térébrant d’un pubis – ils teignent la mémoire d’une odeur futile, comme une chanson de Dona Summer sur le pas ennuyé de la boîte de nuit où l’on vînt rechercher la coupure d’une lame ou cet empire luisant au bord des cuisses – mais jamais l’appel de la chair, ni le cri de l’être, nevermore! Leurs pages brouillent, énoncent l’impasse du temps sans rien en dire exactement, la photographie jaunie des auteurs jadis connus pour leurs positions cassantes, ne casse plus rien. Elle pâlit dans une lueur de chevet embarrassé, tout en aiguisant certaine douleur : quelle chance l’on eût de ne pas se fourvoyer dans leur suite, mais d’être battu à la sortie de cette boîte à tubes aujourd’hui en ruines…
Et puis on tombe sur les doubles : des volumes usés à la corde, et cornés comme la pochette des vinyles des Pistols, Ramones ou les Stooges : Antonin Artaud, LF Céline, Grasset d’Orcet, Thomas Wolfe, Lautréamont, Fitzgerald, Witkacy… qu’on ne comprit d’abord tels qu’ils sont — et qui subitement déchirent le ciel plein de veines où l’on est mort tant de fois – perdus à tout, et trouvés maintenant comme ils sont : toujours découronnés, si purs – indiciblement obscènes. A qui l’on fît tant de mal, sauf qu’ils donnent envie de battre le dépit de Tout!
Je n’ai sciemment pas cité d’autres noms pour laisser libre le lecteur de concevoir, imaginer, spéculer – et puis c’est une version parcellaire de l’usage, non : de l’usure poundienne de la bibliothèque… Les uns font acte de boutique, éliment, compensent, trafiquent le prix du sang quand d’autres coupent, vont au vif, maudissent et se damnent, nom de dieu! pour vivre la passion de survivre à tout, passer des caps, saillir et faire hommage à l’ancêtre inconnu qui osât trancher, faire scission, trahir – pas exactement profaner, dénaturer, passer outre…
A moins de consommer la fureur qui élève froidement au lieu de courber – des chiens assis nous snobèrent, pas qu’ils mordissent mais nous ont mis à une place impossible, d’où rien n’arrive décisivement – oubliez-moi, c’est ça, effaçons-nous! Baudelaire sans E après le B a bien dit comme il était indispensable de ne pas citer ceux qui voulûrent nous tuer au risque de leur concéder une part de postérité – grisons-les comme ils se grisèrent. La gloire est faite pour l’éclaireur, et non les éteignoirs!…
A part tout ça, sans des livres, on serait mort. La Providence use d’abord de papier, de vinyle – et de celluloïd. La réalité n’existe pas – eux forgent le Réel. Nous y sommes!
« L’amour n’est-il valable qu’en période pré-révolutionnaire? » (Debord)
Nowhereland – 6 Juin 2012