 Les impasses de la démocratisation scolaire.
Les impasses de la démocratisation scolaire.
Sur une prétendue crise des vocations scientifiques.
Extrait du livre de Bernard Convert
Éditions Raisons d'Agir, octobre 2006, pp.5-11.
(Publié avec l'aimable autorisation des Éditions Raisons d'Agir)
INTRODUCTION
La « désaffection » pour les études scientifiques, ou comment un problème peut en cacher un autre
![]() on contente de voir fuir ses cerveaux, la France ne les fabriquerait même plus. Elle souffrirait d’une « crise des vocations scientifiques », d’une « désaffection » de ses jeunes pour les études scientifiques. Cette « crise », dont on verra qu’elle n’est pas tout à fait celle que l’on croit, n’est pas anodine. Elle est révélatrice d’une évolution majeure du système scolaire français : l’inexorable poussée, avec la croissance du nombre d’étudiants, d’un enseignement supérieur professionnalisé, au détriment des disciplines théoriques. L’accroissement à marche forcée du taux d’accès au baccalauréat, dans un contexte de chômage persistant des jeunes, a produit une évolution de la demande étudiante dans le sens d’un utilitarisme accru des choix d’orientation. En réponse à cette demande, la multiplication des filières professionnalisées est aussi une solution à la nécessité pour les universités de trouver de nouvelles sources de financement. Elle est encouragée par le secteur privé de l’économie, qui rémunère mieux les diplômes « appliqués » que les diplômes « théoriques ». Ce déplacement vers un enseignement supérieur plus appliqué et plus en accord avec la demande économique du moment affecte toutes les universités, toutes les disciplines, et entraîne une conversion des valeurs universitaires : les valeurs d’universalité, d’autonomie, de liberté critique incarnées par l’enseignement supérieur et la recherche cèdent progressivement la place à des valeurs « managériales » de performance, de contrôle de qualité et d’efficacité économique. Derrière cette « crise des vocations scientifiques », c’est bien toute la question de l’évolution de l’enseignement supérieur et de la recherche qui est en jeu.
on contente de voir fuir ses cerveaux, la France ne les fabriquerait même plus. Elle souffrirait d’une « crise des vocations scientifiques », d’une « désaffection » de ses jeunes pour les études scientifiques. Cette « crise », dont on verra qu’elle n’est pas tout à fait celle que l’on croit, n’est pas anodine. Elle est révélatrice d’une évolution majeure du système scolaire français : l’inexorable poussée, avec la croissance du nombre d’étudiants, d’un enseignement supérieur professionnalisé, au détriment des disciplines théoriques. L’accroissement à marche forcée du taux d’accès au baccalauréat, dans un contexte de chômage persistant des jeunes, a produit une évolution de la demande étudiante dans le sens d’un utilitarisme accru des choix d’orientation. En réponse à cette demande, la multiplication des filières professionnalisées est aussi une solution à la nécessité pour les universités de trouver de nouvelles sources de financement. Elle est encouragée par le secteur privé de l’économie, qui rémunère mieux les diplômes « appliqués » que les diplômes « théoriques ». Ce déplacement vers un enseignement supérieur plus appliqué et plus en accord avec la demande économique du moment affecte toutes les universités, toutes les disciplines, et entraîne une conversion des valeurs universitaires : les valeurs d’universalité, d’autonomie, de liberté critique incarnées par l’enseignement supérieur et la recherche cèdent progressivement la place à des valeurs « managériales » de performance, de contrôle de qualité et d’efficacité économique. Derrière cette « crise des vocations scientifiques », c’est bien toute la question de l’évolution de l’enseignement supérieur et de la recherche qui est en jeu.
***
Le symptôme est apparu au milieu des années 1990 : dans les facs de sciences, les amphithéâtres ont com-mencé à se vider. La physique et la chimie ont été les premières touchées, puis ce fut le tour de la biologie et des mathématiques. Le phénomène persistant, les enseignants ont commencé à s’en inquiéter et la presse à en parler (1). Dès que le phénomène est parvenu à l’existence publique, les explications n’ont pas manqué, avancées par les journalistes, les politiques ou les scientifiques eux-mêmes, explications souvent faussement explicatives, à la manière de la virtus dormitiva des médecins de Molière (c’est ainsi qu’une ministre de la Recherche « expliquait » qu’il fallait y voir un « manque de désir » pour les sciences (2)) ou relevant du « même pas faux », ce registre du discours tout à la fois assez convenu pour s’attirer l’assentiment du plus grand nombre et assez flou pour être impossible à contredire (la « perte du goût de l’effort » par exemple).
![]() Pour les uns, les journalistes en particulier, c’est l’image des sciences qui serait en cause : si les jeunes boudent les sciences, c’est que l’actualité leur en donne chaque jour des images négatives. « À ce jour […], aucune enquête n’a été lancée pour comprendre les causes de cette désaffection. Les uns et les autres s’accordent néanmoins pour penser qu’il s’agit avant tout d’une question d’image. La crise a écorné le prestige de la science et de la recherche en montrant que le progrès scientifique ne suffit pas à tout résoudre. La maladie de la vache folle, le risque nucléaire, le chômage : ces divers maux souvent attribués au progrès dans le domaine de l’automatisation concourent au même mouvement (3). » On reconnaît là, malgré l’absence de résultats d’enquête qui oblige à des artifices rhétoriques (« les uns et les autres s’accordent néanmoins à penser »), la propension à expliquer l’événement par l’événement (la crise des filières scientifiques par celle de la vache folle), propension souvent associée à la croyance selon laquelle ce qu’un événement a fait, un autre événement peut le défaire : il suffirait d’une « Année de la Physique » bien médiatisée pour voir revenir les étudiants dans les amphis. Ainsi, dans un dossier du Monde Dossiers et documents (4), on lit : « Outre-Rhin […], une Année nationale de la Physique avait ainsi été décrétée en 2000. […] Selon les chiffres du gouvernement allemand, dit le physicien Édouard Brézin, président de l’Académie des sciences, les inscriptions ont bondi de plus de 20 % dans les années qui ont suivi l’événement ». Or les statistiques montrent que les inscriptions en physique avaient commencé à augmenter en Allemagne dès 1998, deux ans avant cette Année nationale de la Physique (5). Ces arguments en termes d’image ont peu de fondements. Les enquêtes d’opinion montrent non seulement que la science et le métier de chercheur scientifique jouissent toujours d’un grand prestige, mais surtout que ce n’est jamais au nom de tels motifs que les étudiants font leur choix.
Pour les uns, les journalistes en particulier, c’est l’image des sciences qui serait en cause : si les jeunes boudent les sciences, c’est que l’actualité leur en donne chaque jour des images négatives. « À ce jour […], aucune enquête n’a été lancée pour comprendre les causes de cette désaffection. Les uns et les autres s’accordent néanmoins pour penser qu’il s’agit avant tout d’une question d’image. La crise a écorné le prestige de la science et de la recherche en montrant que le progrès scientifique ne suffit pas à tout résoudre. La maladie de la vache folle, le risque nucléaire, le chômage : ces divers maux souvent attribués au progrès dans le domaine de l’automatisation concourent au même mouvement (3). » On reconnaît là, malgré l’absence de résultats d’enquête qui oblige à des artifices rhétoriques (« les uns et les autres s’accordent néanmoins à penser »), la propension à expliquer l’événement par l’événement (la crise des filières scientifiques par celle de la vache folle), propension souvent associée à la croyance selon laquelle ce qu’un événement a fait, un autre événement peut le défaire : il suffirait d’une « Année de la Physique » bien médiatisée pour voir revenir les étudiants dans les amphis. Ainsi, dans un dossier du Monde Dossiers et documents (4), on lit : « Outre-Rhin […], une Année nationale de la Physique avait ainsi été décrétée en 2000. […] Selon les chiffres du gouvernement allemand, dit le physicien Édouard Brézin, président de l’Académie des sciences, les inscriptions ont bondi de plus de 20 % dans les années qui ont suivi l’événement ». Or les statistiques montrent que les inscriptions en physique avaient commencé à augmenter en Allemagne dès 1998, deux ans avant cette Année nationale de la Physique (5). Ces arguments en termes d’image ont peu de fondements. Les enquêtes d’opinion montrent non seulement que la science et le métier de chercheur scientifique jouissent toujours d’un grand prestige, mais surtout que ce n’est jamais au nom de tels motifs que les étudiants font leur choix.
![]() Pour d’autres observateurs, ce serait une question de pédagogie. L’enseignement scientifique serait « trop académique ». La physique, en particulier, aurait souffert d’une mathématisation excessive, au détriment de la curiosité scientifique, du goût du concret et de l’approche expérimentale. Mais ces débats récurrents relèvent avant tout de conflits entre disciplines, ou entre générations au sein d’une même discipline. Force est de constater que les initiatives pédagogiques qui se sont multipliées, de l’école primaire au lycée, bien qu’unanimement saluées pour leur qualité, ne réussissent pas à contrarier la tendance à la chute des inscriptions dans les facultés de sciences.
Pour d’autres observateurs, ce serait une question de pédagogie. L’enseignement scientifique serait « trop académique ». La physique, en particulier, aurait souffert d’une mathématisation excessive, au détriment de la curiosité scientifique, du goût du concret et de l’approche expérimentale. Mais ces débats récurrents relèvent avant tout de conflits entre disciplines, ou entre générations au sein d’une même discipline. Force est de constater que les initiatives pédagogiques qui se sont multipliées, de l’école primaire au lycée, bien qu’unanimement saluées pour leur qualité, ne réussissent pas à contrarier la tendance à la chute des inscriptions dans les facultés de sciences.
![]() Pour d’autres encore, ce serait la longueur d’un cursus réputé difficile qui éloignerait les étudiants des filières scientifiques, au profit d’études plus « faciles » et plus « payantes » — le commerce, le droit, la communication. L’argument de la difficulté est plus sérieux. Les études scientifiques sont celles où la réussite, toutes choses égales par ailleurs, est la plus difficile. Cet argument ne fait cependant que différer l’explication : car s’il est bien vrai que les études scientifiques ont une telle image, il reste à expliquer pourquoi cette réputation de difficulté, qui ne date pas d’hier, éloignerait aujourd’hui les étudiants, alors qu’il y a vingt ans les universités scientifiques « refusaient » littéralement du monde (6).
Pour d’autres encore, ce serait la longueur d’un cursus réputé difficile qui éloignerait les étudiants des filières scientifiques, au profit d’études plus « faciles » et plus « payantes » — le commerce, le droit, la communication. L’argument de la difficulté est plus sérieux. Les études scientifiques sont celles où la réussite, toutes choses égales par ailleurs, est la plus difficile. Cet argument ne fait cependant que différer l’explication : car s’il est bien vrai que les études scientifiques ont une telle image, il reste à expliquer pourquoi cette réputation de difficulté, qui ne date pas d’hier, éloignerait aujourd’hui les étudiants, alors qu’il y a vingt ans les universités scientifiques « refusaient » littéralement du monde (6).
![]() La thèse défendue dans ce livre est la suivante : si toutes ces explications sont insuffisantes, c’est parce qu’elles se trompent de symptôme. Aveuglés par la chute des effectifs scientifiques dans les premiers cycles de l’université, inquiets pour l’avenir scientifique et technologique du pays, les commentateurs, qu’ils soient journalistes, politiques ou membres de sociétés savantes, prennent le phénomène à sa valeur facial : si les étudiants ne s’inscrivent plus en sciences, c’est qu’ils « boudent » les sciences, c’est qu’ils n’aiment plus les sciences ou qu’ils s’en méfient, bref c’est qu’il y a un problème avec la science, son image, son enseignement, ses difficultés…
La thèse défendue dans ce livre est la suivante : si toutes ces explications sont insuffisantes, c’est parce qu’elles se trompent de symptôme. Aveuglés par la chute des effectifs scientifiques dans les premiers cycles de l’université, inquiets pour l’avenir scientifique et technologique du pays, les commentateurs, qu’ils soient journalistes, politiques ou membres de sociétés savantes, prennent le phénomène à sa valeur facial : si les étudiants ne s’inscrivent plus en sciences, c’est qu’ils « boudent » les sciences, c’est qu’ils n’aiment plus les sciences ou qu’ils s’en méfient, bref c’est qu’il y a un problème avec la science, son image, son enseignement, ses difficultés…
![]() Et si ce n’étaient pas « les sciences » qui étaient en question dans cette affaire ?
Et si ce n’étaient pas « les sciences » qui étaient en question dans cette affaire ?
Un fait devrait troubler cette belle assurance : quand on observe la courbe d’évolution des inscriptions dans l’enseignement supérieur entre 1990 et 2000, on voit immédiatement que ce ne sont pas « les sciences » qui ont été touchées par la « désaffection », mais bien l’ensemble des universités, ou plus précisément l’ensemble des disciplines théoriques enseignées à l’université : lettres, sciences humaines, sciences économiques et droit connaissent comme les sciences, sur la même période, une chute significative de leurs effectifs. L’image de ces disciplines serait-elle, elle aussi, ternie par l’actualité ? Ces disciplines seraient-elles, elles aussi, devenues soudain trop difficiles ? La pédagogie des lettres ou du droit serait-elle, elle aussi, à revoir ?
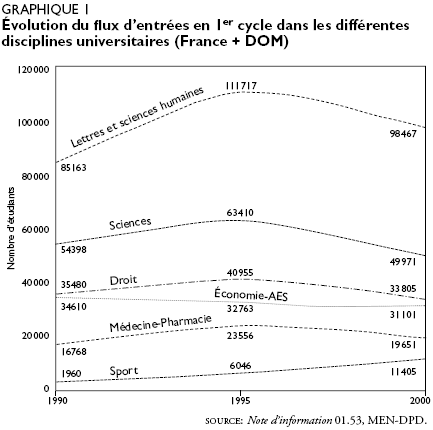 | ---------------------------------------------- Le numéro du Monde Dossiers et documents de juin 2005 consacré aux sciences, à l’occasion du centenaire des premières publications d’Einstein, affiche une courbe semblable à la nôtre dans un article ayant pour titre : « Ils ont perdu la vocation. Depuis le milieu des années 1990, les inscriptions en disciplines scientifiques dans l’enseignement supérieur ont baissé ». Pourtant, le graphique montre à l’évidence que le même phénomène touche aussi les lettres et le droit. Du coup, le titre du graphique : « Le milieu des années 1990 marque le début de la désaffection des études scientifiques et littéraires » contredit le titre de l’article (c’est nous qui soulignons). |
On n’a parlé et on ne continue de parler que de la « crise des sciences », sans doute parce que le thème de la pénurie de scientifiques inquiète plus que celui de la pénurie de littéraires, mais la désaffection pour les études scientifiques n’est qu’un élément d’un phénomène plus vaste, et c’est bien ce phénomène global qu’il faut expliquer. En tout état de cause, on devrait comprendre, à la vue de ces courbes, l’inanité du raisonnement qui prend le symptôme de la chute des effectifs scientifiques pour argent comptant : si les jeunes désertent les sciences, c’est qu’ils n’aiment plus les sciences. Comment leur en faire retrouver le goût ? dit-on dans les rapports de l’Académie des sciences. Mais alors quid des lettres, quid du droit ? Ce n’est donc pas de désaffection pour les sciences que l’on doit parler mais bien d’une chute des inscriptions qui affecte, à partir d’une même date, 1995, l’ensemble des disciplines théoriques que représente traditionnellement l’université des lettres et des sciences. Cette baisse des inscriptions universitaires se poursuit après 2000 partout, à l’exception notable de la médecine-pharmacie. De 2000 à 2005, on observe une baisse persistante des flux d’entrées en première année d’université, en droit (-6 %), en sciences économiques et AES (-7 %), une baisse atténuée en lettres et sciences humaines (-2,5 %), un arrêt de la croissance en Staps7 (-1,5 %) et une chute accentuée des flux d’entrées en sciences (-19 %, soit -9 359 étudiants), « compensée » par une croissance sans précédent des inscriptions en médecine-pharmacie (+46 %, soit + 9 123 étudiants) (8).
![]() Pourquoi cette chute ? Pourquoi à cette date ? En réalité, la « désaffection pour les études scientifiques », tout comme la chute des inscriptions dans les universités en lettres et en droit qui lui est contemporaine, est la conséquence d’un mouvement de fond qui fut un temps masqué par la très forte croissance du nombre de bacheliers : le détournement des orientations des étudiants vers les formations professionnalisées. Ce déplacement trouve lui-même son origine dans la crise de l’emploi, qui porte, depuis une vingtaine d’années, les générations nouvelles — et parmi elles en premier lieu les élèves de milieu défavorisé, bénéficiaires de la démocratisation — à valoriser les diplômes les plus facilement monnayables sur le marché de l’emploi.
Pourquoi cette chute ? Pourquoi à cette date ? En réalité, la « désaffection pour les études scientifiques », tout comme la chute des inscriptions dans les universités en lettres et en droit qui lui est contemporaine, est la conséquence d’un mouvement de fond qui fut un temps masqué par la très forte croissance du nombre de bacheliers : le détournement des orientations des étudiants vers les formations professionnalisées. Ce déplacement trouve lui-même son origine dans la crise de l’emploi, qui porte, depuis une vingtaine d’années, les générations nouvelles — et parmi elles en premier lieu les élèves de milieu défavorisé, bénéficiaires de la démocratisation — à valoriser les diplômes les plus facilement monnayables sur le marché de l’emploi.
![]()
(1) Voir par exemple « Les études scientifiques connaissent un déclin de leurs effectifs », Le Monde, 5 août 1998 ; « Les étudiants boudent les sciences », Libération, 16-17 octobre 1999 ; « Mais pourquoi les jeunes boudent-ils les sciences ? », Le Nouvel Observateur, 21-27 octobre 1999.
(2) Le Monde de l’éducation, octobre 2002.
(3) Le Nouvel Observateur, 21-27 octobre 1999.
(4) Le Monde Dossiers et documents, 6 juin 2005.
(5) Voir Guillaume Troendle, Mapping Physics Students in Europe, Mulhouse, European Physical Society, 2004. Et les inscriptions en chimie ont suivi la même évolution sans qu’aucune Année nationale de la chimie ait été organisée…
(6) Vers la fin des années 1980, une université avait attiré l’attention des médias sur l’insuffisance de ses moyens face à une population sans cesse croissante d’étudiants en sciences, en menaçant d’organiser un « tirage au sort » des étudiants à l’inscription.
(7) Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
(8) Le fait nouveau des dernières années est la concurrence qui oppose désormais la médecine aux sciences.