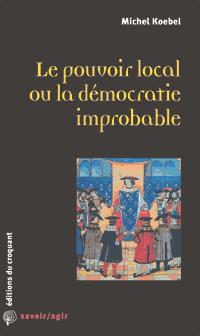 Le magazine de l'Homme Moderne
Le magazine de l'Homme Moderne
Richard Brun - Michel Koebel :
Discussion à propos du livre de Michel Koebel : Le pouvoir local ou la démocratie improbable.
![]() ette discussion sur le Net s'est amorcée à partir des remarques de Richard Brun (co-listier) sur la liste de discussion Champs et s'est poursuivie en aparté avec Michel Koebel (sociologue, auteur du livre et co-listier également).
ette discussion sur le Net s'est amorcée à partir des remarques de Richard Brun (co-listier) sur la liste de discussion Champs et s'est poursuivie en aparté avec Michel Koebel (sociologue, auteur du livre et co-listier également).
![]() Richard BRUN : Certains d'entre-nous ont sans doute lu de notre co-listier, le sociologue Michel Koebel (maître de conférences à l'université de Reims) dans la collection Savoir/Agir : "Le pouvoir local et la démocratie improbable", éd. du Croquant, janvier 2006.
Richard BRUN : Certains d'entre-nous ont sans doute lu de notre co-listier, le sociologue Michel Koebel (maître de conférences à l'université de Reims) dans la collection Savoir/Agir : "Le pouvoir local et la démocratie improbable", éd. du Croquant, janvier 2006.
« Les ouvriers sont ainsi 30 fois moins représentés que les cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les maires [...], respectivement 130 fois et 80 fois moins au sein des conseils généraux et régionaux. Cette représentation inégale oppose principalement les ouvriers et les employés aux catégories sociales les mieux dotées en capital économique et en capital culturel » conclut, entre autres, Michel Koebel à la page 115.
Je suis impressionné par la première partie sur la sélection sociale des élus. Il y a là un énorme travail de collecte et d'analyse de données que l'on ne trouve pas en deux clics sur l'Internet. Sur l'improbabilité d'une égalité des citoyens dans une société marquée par la domination et les inégalités en termes de capital, l'analyse me semble à la fois rigoureuse et claire.
Voici quelques interrogations qui sortent un peu du cadre de l'analyse, en vrac :
- Puisque être un "élu" c'est à la fois être celui qui représente (et qui devrait ressembler à ses électeurs) et celui qui détient l'autorité (à qui l'on reconnaît la compétence de décider), n'est-il pas possible de tracer une cartographie de la répartition du capital symbolique et par conséquent de la domination à partir des données collectées ? La montée en puissance entre 1977 et 2001 des détenteurs du capital culturel (cadres) au détriment des détenteurs du capital éco (chefs d'entreprise) serait à cet égard particulièrement significative (tableau 3).
![]() Michel KOEBEL : Je ne suis pas d’accord avec la première assertion : quand la Constitution évoque la démocratie représentative, elle ne précise pas qu'un élu doit " ressembler à ses électeurs ". La représentation est plutôt à prendre ici comme " porte-parole ". C’est en ce sens que le manque de représentativité des élus est balayé d’un revers de main par nombre de politistes et politologues français, qu’ils ne s’y intéressent même pas et que ces données restent cantonnées dans les ordinateurs de deux fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur (quand j’ai récupéré les données sur les catégories socioprofessionnelles des élus locaux, l’un d’entre eux s’est déclaré étonné de voir que son travail allait enfin servir quelque chose, et que cela faisait des années que personne ne les lui avait demandés…).
Michel KOEBEL : Je ne suis pas d’accord avec la première assertion : quand la Constitution évoque la démocratie représentative, elle ne précise pas qu'un élu doit " ressembler à ses électeurs ". La représentation est plutôt à prendre ici comme " porte-parole ". C’est en ce sens que le manque de représentativité des élus est balayé d’un revers de main par nombre de politistes et politologues français, qu’ils ne s’y intéressent même pas et que ces données restent cantonnées dans les ordinateurs de deux fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur (quand j’ai récupéré les données sur les catégories socioprofessionnelles des élus locaux, l’un d’entre eux s’est déclaré étonné de voir que son travail allait enfin servir quelque chose, et que cela faisait des années que personne ne les lui avait demandés…).
![]() R.B. : Sur la définition de la représentativité, on est bien d'accord que la " ressemblance " n'est pas un concept juridique. Toutefois, je persiste à penser que l'illusion de la représentativité de la démocratie représentative est un véritable enjeu et que c'est ce qui fonde en partie la légitimité du système politique.
R.B. : Sur la définition de la représentativité, on est bien d'accord que la " ressemblance " n'est pas un concept juridique. Toutefois, je persiste à penser que l'illusion de la représentativité de la démocratie représentative est un véritable enjeu et que c'est ce qui fonde en partie la légitimité du système politique.
Dans la formule " élus du peuple par le peuple ", il y a bien l'idée que les élus sont censés être issus du " peuple " et donc lui ressembler. Au passage, des questions comme la parité hommes/femmes (qui reprend bien cette idée que si 50 % de la population est une femme, alors 50 % des élus devraient également ne pas être un homme) ou comme la " discrimination/ségrégation positive " montrent bien que le sujet est tout à fait sensible.
Quant aux statistiques inutilisées, si les dominants se posent si peu de questions sur les mécanismes de la domination, c'est peut-être qu'ils préfèrent ne pas avoir de réponses ?
![]() M.K. : C’est plutôt dans un deuxième temps que l’on peut se poser la question de la capacité des élus à représenter les électeurs, quand on s’aperçoit qu’ils ne représentent pour la plupart que le pôle le plus favorisé de la hiérarchie sociale. Je veux parler principalement des élus locaux faisant partie de l’exécutif, ceux qui détiennent le plus de pouvoir dans l’espace local, c’est-à-dire en particulier les maires, quelques adjoints, et surtout ceux qui font partie des communes urbaines, et notamment les 2 650 communes — sur 36 565 — de plus de 3 500 habitants, celles qui regroupent deux-tiers de la population française. Faire partie d’un groupe social favorisé (sur les plans économique, culturel, etc.) donne-t-il plus de compétence à prendre en compte (et d’abord à percevoir, à comprendre, avant même de défendre) les intérêts d’autres groupes sociaux ? Cette capacité à représenter ne fait pas partie des compétences actuellement exigibles pour prétendre décider à la place des autres. Cela tourne plus autour des capacités à s’exprimer en public, à communiquer, à gérer des dossiers complexes. Les caractéristiques sociales des élus, leur façon de vivre, les lieux qu’ils fréquentent, les personnes qu’ils rencontrent, ne les prédisposent pas à entendre ces différentes catégories d’intérêts. Pire : ils sont plutôt prédisposés à entendre les intérêts de ceux qui sont socialement les plus proches d’eux. Bourdieu disait même que, à la limite, c’est en servant leurs propres intérêts que les hommes politiques servent le mieux ceux de leurs mandants, ceux qu’ils représentent réellement. Malheureusement, seuls quelques dossiers (comme la pollution de l’air par exemple) concernent toutes les catégories sociales. De plus, les conditions d’exercice d’un mandat électif, surtout lorsqu’on occupe des positions élevées dans la hiérarchie d’une collectivité, rendent difficile la prise de distance nécessaire pour une construction méthodique de certaines catégories d’intérêts, en particulier celles qui ne sont pas construites par des organisations spécifiques comme les syndicats, les associations, et les autres organismes professionnels, sociaux ou politiques qui parlent au nom d’une partie de la population. Cette prise de distance devrait d’ailleurs commencer, chez les élus, mais aussi chez les responsables de mouvements politiques, sociaux, de groupes de pression etc., par la prise de conscience de la relativité sociale de leurs propres enjeux et intérêts. Et cela est loin d’être simple et facile.
M.K. : C’est plutôt dans un deuxième temps que l’on peut se poser la question de la capacité des élus à représenter les électeurs, quand on s’aperçoit qu’ils ne représentent pour la plupart que le pôle le plus favorisé de la hiérarchie sociale. Je veux parler principalement des élus locaux faisant partie de l’exécutif, ceux qui détiennent le plus de pouvoir dans l’espace local, c’est-à-dire en particulier les maires, quelques adjoints, et surtout ceux qui font partie des communes urbaines, et notamment les 2 650 communes — sur 36 565 — de plus de 3 500 habitants, celles qui regroupent deux-tiers de la population française. Faire partie d’un groupe social favorisé (sur les plans économique, culturel, etc.) donne-t-il plus de compétence à prendre en compte (et d’abord à percevoir, à comprendre, avant même de défendre) les intérêts d’autres groupes sociaux ? Cette capacité à représenter ne fait pas partie des compétences actuellement exigibles pour prétendre décider à la place des autres. Cela tourne plus autour des capacités à s’exprimer en public, à communiquer, à gérer des dossiers complexes. Les caractéristiques sociales des élus, leur façon de vivre, les lieux qu’ils fréquentent, les personnes qu’ils rencontrent, ne les prédisposent pas à entendre ces différentes catégories d’intérêts. Pire : ils sont plutôt prédisposés à entendre les intérêts de ceux qui sont socialement les plus proches d’eux. Bourdieu disait même que, à la limite, c’est en servant leurs propres intérêts que les hommes politiques servent le mieux ceux de leurs mandants, ceux qu’ils représentent réellement. Malheureusement, seuls quelques dossiers (comme la pollution de l’air par exemple) concernent toutes les catégories sociales. De plus, les conditions d’exercice d’un mandat électif, surtout lorsqu’on occupe des positions élevées dans la hiérarchie d’une collectivité, rendent difficile la prise de distance nécessaire pour une construction méthodique de certaines catégories d’intérêts, en particulier celles qui ne sont pas construites par des organisations spécifiques comme les syndicats, les associations, et les autres organismes professionnels, sociaux ou politiques qui parlent au nom d’une partie de la population. Cette prise de distance devrait d’ailleurs commencer, chez les élus, mais aussi chez les responsables de mouvements politiques, sociaux, de groupes de pression etc., par la prise de conscience de la relativité sociale de leurs propres enjeux et intérêts. Et cela est loin d’être simple et facile.
Concernant une possible cartographie de la répartition du capital symbolique, c’est un projet intéressant. Concernant les élus locaux en France, les données auxquelles j’ai eu accès interdisent une exploitation de type analyse factorielle qui pourrait conduire à une possible schématisation. Je n’ai pu qu’interroger la base de données au travers des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur mais je ne dispose pas de la base elle-même. Je suis en train d’engager les démarches pour l’obtenir. De manière plus générale, une partie de la réponse pourrait provenir d’une relative concordance entre prestige social des professions et domination politique : la part de capital symbolique attachée aux positions professionnelles est un moyen qui me semble de plus en plus prégnant dans le mode d’entrée en politique. Il faut y ajouter bien entendu l’héritage proprement culturel d’un engagement politique des ascendants, et l’accumulation de capital symbolique propre à l’individu à travers son parcours associatif, syndical, partisan et électif.
![]() R.B. : - Je suis frappé par le peu de légitimité que les dominés s'accordent à eux mêmes : à la fois, le faible nombre d'ouvriers candidats (graphique 3) et le faible nombre de candidats ouvriers élus (graphique 4), tout semble montrer que les seules personnes légitimes pour exercer un mandat électif sont celles qui occupent une position d'autorité dans la société civile. Faut-il y voir la marque de la soumission des dominés à la domination ?
R.B. : - Je suis frappé par le peu de légitimité que les dominés s'accordent à eux mêmes : à la fois, le faible nombre d'ouvriers candidats (graphique 3) et le faible nombre de candidats ouvriers élus (graphique 4), tout semble montrer que les seules personnes légitimes pour exercer un mandat électif sont celles qui occupent une position d'autorité dans la société civile. Faut-il y voir la marque de la soumission des dominés à la domination ?
- Le graphique 2 sur la comparaison entre les CSP des élus et de leur administrés, même s'il se base sur un échantillon réduit, me paraît particulièrement instructif. Visuellement, on obtient 2 pyramides inversées qui se font face : la société "réelle", faite majoritairement d'ouvriers et d'employés, et sa représentation (au double sens du terme) sous la forme d'une société des classes moyennes (cadres moyens et supérieurs), telle que la fantasment les médias, les partis politiques et autres spécialistes du marketing politique.
![]() M. K. : Ce graphique est le seul que je n’ai pas construit moi-même. C’est en cela qu’il m'apparaissait intéressant : c’était la première fois (en 2003) que la Direction générale des collectivités locales sortait officiellement une telle comparaison. Je n’ai pas voulu polémiquer outre mesure sur la fantaisie des références (mettre les " retraités " et les " autres sans activité professionnelle " dans la " population active de plus de 15 ans " donne une indication sur le niveau de compétences de ceux qui produisent ces chiffres ; la référence au n°792 de Insee Première pour accréditer ces chiffres est d’ailleurs inexacte — heureusement d’ailleurs pour l’Insee !).
M. K. : Ce graphique est le seul que je n’ai pas construit moi-même. C’est en cela qu’il m'apparaissait intéressant : c’était la première fois (en 2003) que la Direction générale des collectivités locales sortait officiellement une telle comparaison. Je n’ai pas voulu polémiquer outre mesure sur la fantaisie des références (mettre les " retraités " et les " autres sans activité professionnelle " dans la " population active de plus de 15 ans " donne une indication sur le niveau de compétences de ceux qui produisent ces chiffres ; la référence au n°792 de Insee Première pour accréditer ces chiffres est d’ailleurs inexacte — heureusement d’ailleurs pour l’Insee !).
Cette représentation inversée d’un point du vue social n’est pas propre à la France. Lors des consultations référendaires ou parlementaires effectuées en 2004 et 2005 dans plusieurs pays européens à propos du projet de Constitution européenne, cette fracture entre ce qui est considéré comme des évidences dans les représentations nationales (la quasi totalité des parlements étaient pour ce projet, dans des proportions atteignant allègrement les 80 %) et qui peut être entièrement contredit par un référendum ou par des sondages d’opinion (et rappelons que les votes ne concernent pas toutes les catégories de la population : les ouvriers et les employés s’abstenant beaucoup plus que les autres catégories socioprofessionnelles). Je le répète : appartenir à une catégorie sociale, c’est avoir des conditions d’existence semblables, et aussi des pratiques et des représentations semblables (sur le plan statistique) puisqu’elles en sont en grande partie le produit. Qui pourrait penser que les choix politiques échapperaient à cette logique ? Et ces grandes différences, seulement visibles dans des circonstances particulières (comme pour le projet de constitution européenne ou pour le contrat première embauche) dans lesquelles les médias sont obligés de présenter une image de " l’opinion des Français " et son évolution, montrent bien que la prise en compte des intérêts de certaines catégories de la population ne compte pour pas grand chose dans les décisions des gouvernants, du moins compte moins que d’autres intérêts, notamment économiques et financiers, parce que ceux-ci, avant d’avoir des effets durables sur les premiers, serviront d’abord les seconds.
![]() R.B. : Concernant la non prise en compte des intérêts de certaines catégories de la population, il me semble que c'est moins à cause d'un calcul cynique qui voudrait qu'il vaut mieux avantager les marchés financiers et le " Grand Kapital " au détriment des " petites gens ", que parce que les élus considèrent que leur propre intérêt est " universel " et que ce qui est bon pour eux et bon pour tous. Or comme les élus appartiennent aux seules catégories dominantes, seuls les intérêts des dominants sont pris en compte...
R.B. : Concernant la non prise en compte des intérêts de certaines catégories de la population, il me semble que c'est moins à cause d'un calcul cynique qui voudrait qu'il vaut mieux avantager les marchés financiers et le " Grand Kapital " au détriment des " petites gens ", que parce que les élus considèrent que leur propre intérêt est " universel " et que ce qui est bon pour eux et bon pour tous. Or comme les élus appartiennent aux seules catégories dominantes, seuls les intérêts des dominants sont pris en compte...
Il me semble justement que l'intérêt d'étudier les élus des collectivités locales c'est de se trouver face à des gens qui sont rarement des professionnels de la politique : les conseillers municipaux, régionaux ou généraux ne vivent pas dans un monde de salons parisiens déconnectés des réalités sociales (ou du moins, peu d'entre eux). Au contraire, ils font partie du monde social, ils sont partie prenante...
![]() M. K. : Ma démonstration va dans le sens contraire de votre impression. J’explique dans mon livre pourquoi et comment le pouvoir local se concentre sur quelques individus (une partie de l’exécutif local : le maire, quelques adjoints, quelques fonctionnaires très " politiques ") et que le reste n’est largement qu’un simulacre de démocratie. Ce sont eux qui sont le plus " professionnalisés ", ceux qui cumulent les mandats et dont Daniel Gaxie dit qu’ils vivent de la politique et pour la politique, et pour qui « la maladie, la vieillesse avancée, ou la mort sont les principales causes d’interruption de l’activité politique ».
M. K. : Ma démonstration va dans le sens contraire de votre impression. J’explique dans mon livre pourquoi et comment le pouvoir local se concentre sur quelques individus (une partie de l’exécutif local : le maire, quelques adjoints, quelques fonctionnaires très " politiques ") et que le reste n’est largement qu’un simulacre de démocratie. Ce sont eux qui sont le plus " professionnalisés ", ceux qui cumulent les mandats et dont Daniel Gaxie dit qu’ils vivent de la politique et pour la politique, et pour qui « la maladie, la vieillesse avancée, ou la mort sont les principales causes d’interruption de l’activité politique ».
Une remarque cependant pour compléter le tableau : dernièrement, Georges Gontcharoff, militant actif de la démocratie locale à l’ADELS, dans une note de lecture critique de mon livre qu’il a eu l’amabilité de me transmettre, disait que « nous pourrions mettre en face de chacune des affirmations de ce livre des contre-exemples qui nous rendraient moins affligés ». Il a totalement raison : je ne me suis pas attaché à montrer les exemples où la proximité serait plus grande avec les citoyens, à mettre en exergue les rares endroits où, comme on dit souvent (quand on est un peu militant), " ça marche " (ou du moins ça a l’air de marcher…). Les exceptions, quand on ne parle que d’elles, risquent de faire oublier la terne réalité que je me suis attaché à décrire et que j’ai tenté d’expliquer.
![]() R.B. : Concernant la professionnalisation des élus, si le but de l'étude est de parler de la " caste " des professionnels de la politique, à quoi bon utiliser des statistiques sur leurs origines socio-professionnelles ?
R.B. : Concernant la professionnalisation des élus, si le but de l'étude est de parler de la " caste " des professionnels de la politique, à quoi bon utiliser des statistiques sur leurs origines socio-professionnelles ?
D'autant qu'il est bien évident qu'exercer un mandat électif (associatif, syndical ou politique) à responsabilité est une activité à temps plein, la décharge de l'activité professionnelle est donc une condition indispensable à l'exercice de la démocratie.
Il n'en reste pas moins que sur les 2 650 communes de plus de 3 500 habitants (auxquelles il faut ajouter les structures intercommunales, les Conseils Généraux et Régionaux), il doit y avoir pas loin de 10 000 élus disposant d'un " vrai " pouvoir (maires, adjoints au maire, présidents et vices présidents...). Sur ce nombre, combien y a-t-il de " vrais " professionnels de la politique cumulant les mandats locaux et nationaux et n'ayant plus exercé d'autre activité professionnelle depuis longtemps ? 5 % ? 10 % ? Dans ce cas là, est-ce que l'exception n'est pas constituée par les professionnels de la politique que l'on voit tout le temps à la télé ?
Dans la 1ère partie, l'improbabilité d'une participation des dominés aux assemblées représentatives est clairement montrée et démontrée. En revanche, concernant les nouvelles formes de participation, la même conclusion est avancée sans qu'il y ait de véritable démonstration, il me semble que l'on ne dépasse pas là le stade de la déduction, voire de l'intuition. S'agit-il seulement du manque de place dans une collection à faible pagination ?
![]() M.K. : Oui et non. Concernant les conseils d’enfants et de jeunes, les analyses que j’apporte sont fondées sur une analyse extrêmement approfondie, puisqu’il s’agissait de l’objet de ma thèse de doctorat en sciences sociales. Mais je pouvais difficilement développer cet aspect plus que les autres, ou encore mieux l’argumenter : notre collection ne l’aurait pas permis (j’ai dû tout de même faire d’énormes sacrifices en passant de 250 pages à 125 pour cette dernière version, compte tenu des objectifs de l’association Raisons d’agir à travers cette collection). Pour les autres thématiques, j’ai utilisé des analyses existantes développées par plusieurs chercheurs en science politique, elles-mêmes fondées sur diverses enquêtes, et que j’ai, dans certains cas, complétées par un travail personnel sur les sources de données (notamment pour le référendum local). Par ailleurs, je n’ai pas voulu mettre autant de données chiffrées et de graphiques comme au premier chapitre, et les nombreuses réactions que j’ai déjà reçues en retour par des lecteurs me confortent dans ce choix (certains lecteurs sont allergiques au surcroît de chiffres et de données). Concernant la professionnalisation des élus locaux, je suis en train de mener une enquête sur les frontières entre ce que l’on pourrait appeler les " élus bénévoles " (ou encore les " élus ordinaires ") et les professionnels de la politique dans l’espace local. Je n’ai de loin pas fini d’étudier la question…
M.K. : Oui et non. Concernant les conseils d’enfants et de jeunes, les analyses que j’apporte sont fondées sur une analyse extrêmement approfondie, puisqu’il s’agissait de l’objet de ma thèse de doctorat en sciences sociales. Mais je pouvais difficilement développer cet aspect plus que les autres, ou encore mieux l’argumenter : notre collection ne l’aurait pas permis (j’ai dû tout de même faire d’énormes sacrifices en passant de 250 pages à 125 pour cette dernière version, compte tenu des objectifs de l’association Raisons d’agir à travers cette collection). Pour les autres thématiques, j’ai utilisé des analyses existantes développées par plusieurs chercheurs en science politique, elles-mêmes fondées sur diverses enquêtes, et que j’ai, dans certains cas, complétées par un travail personnel sur les sources de données (notamment pour le référendum local). Par ailleurs, je n’ai pas voulu mettre autant de données chiffrées et de graphiques comme au premier chapitre, et les nombreuses réactions que j’ai déjà reçues en retour par des lecteurs me confortent dans ce choix (certains lecteurs sont allergiques au surcroît de chiffres et de données). Concernant la professionnalisation des élus locaux, je suis en train de mener une enquête sur les frontières entre ce que l’on pourrait appeler les " élus bénévoles " (ou encore les " élus ordinaires ") et les professionnels de la politique dans l’espace local. Je n’ai de loin pas fini d’étudier la question…
![]() R.B. : Sur le fond, les critiques à l'encontre des systèmes de représentation ne me semblent pas spécifiques aux collectivités locales. Les mêmes arguments pourraient être utilisés pour l'État ou l'U.E.
R.B. : Sur le fond, les critiques à l'encontre des systèmes de représentation ne me semblent pas spécifiques aux collectivités locales. Les mêmes arguments pourraient être utilisés pour l'État ou l'U.E.
![]() M. K. : Oui.
M. K. : Oui.
![]() R. B. : Du point de vue de l'organisation des institutions (quel qu'en soit le niveau), l'aspect le moins démocratique me semble résider dans le déséquilibre du rapport de force entre l'exécutif et l'assemblée délibérante. Ce déséquilibre est principalement dû au rôle de l'administration et à son contrôle par l'exécutif. Devant la complexité et la technicité des dossiers, seul celui qui dispose de l'expertise et de la capacité de proposition de l'administration peut espérer surnager. L'élu de base, qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, ne dispose que de ses seules forces pour appréhender les dossiers et n'a donc aucun moyen pour, non seulement, contrôler ou contredire l'exécutif, mais même simplement pour participer à un vrai débat.
R. B. : Du point de vue de l'organisation des institutions (quel qu'en soit le niveau), l'aspect le moins démocratique me semble résider dans le déséquilibre du rapport de force entre l'exécutif et l'assemblée délibérante. Ce déséquilibre est principalement dû au rôle de l'administration et à son contrôle par l'exécutif. Devant la complexité et la technicité des dossiers, seul celui qui dispose de l'expertise et de la capacité de proposition de l'administration peut espérer surnager. L'élu de base, qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, ne dispose que de ses seules forces pour appréhender les dossiers et n'a donc aucun moyen pour, non seulement, contrôler ou contredire l'exécutif, mais même simplement pour participer à un vrai débat.
![]() M.K. : Ce qu’il y a de plus grave encore au niveau local, c’est que le chef de l’exécutif est également celui qui " légifère ", propose et vote les " lois locales ", c’est-à-dire les arrêtés, le budget, etc. Ce cumul est même contraire au principe de notre République de séparation des pouvoirs.
M.K. : Ce qu’il y a de plus grave encore au niveau local, c’est que le chef de l’exécutif est également celui qui " légifère ", propose et vote les " lois locales ", c’est-à-dire les arrêtés, le budget, etc. Ce cumul est même contraire au principe de notre République de séparation des pouvoirs.
![]() R.B. : À propos de la remise en cause du principe de notre République de séparation des pouvoirs par l'organisation des collectivités locales, je ne peux pas être d'accord.
R.B. : À propos de la remise en cause du principe de notre République de séparation des pouvoirs par l'organisation des collectivités locales, je ne peux pas être d'accord.
D'abord, parce qu'au niveau local, personne n'a le pouvoir de légiférer (un arrêté n'a pas de caractère normatif, c'est une énorme " nuance "...). Ensuite, parce que l'exécutif local ne peut se passer de son assemblée délibérante que pour des décisions de gestion courante (mais pas pour le budget, ni pour l'octroi de subventions, ni pour les modifications d'organigramme des services...). Enfin, parce que l'organisation de la démocratie locale est directement calquée sur le modèle national.
Si l'on doit s'inquiéter d'un déséquilibre dans la séparation des pouvoirs, il me semble que l'impact de la construction européenne est bien plus à craindre que celui de la décentralisation (30 % des lois votées par le Parlement national ne sont que des transpositions obligatoires de directives européennes décidées de manière prépondérante par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire, par les exécutifs nationaux...).
![]() M. K. : Cette difficulté à saisir les enjeux, à comprendre les dossiers et toutes les stratégies permettant de faire croire à l’inéluctabilité de certains choix, me fait affirmer qu’il manque à plusieurs niveaux une formation des citoyens. Daniel Gaxie a montré la forte liaison qui existe entre l’intérêt pour la politique et la durée de scolarisation. La compétence politique s’acquiert " indirectement " par le système scolaire : c’est la progressive acquisition des instruments linguistiques et conceptuels qui autorise l’acquisition de la compétence politique, même si le milieu familial joue également un rôle, stimulant ou étouffant. Le rôle des organisations politiques (partis, syndicats,…) est également primordial dans l’acquisition de compétences, mais aussi — et c’est parfois plus important encore — dans l’atténuation du sentiment d’incompétence politique. Dans cette perspective, pour développer la compétence politique dans tous les milieux sociaux et pour lutter contre les " inégalités de politisation ", Daniel Gaxie prône clairement l’introduction dans les programmes scolaires d’un " enseignement politique " et le développement de formations à la politique : pas seulement de timides et vagues sensibilisations au civisme, mais un véritable présentation des forces politiques, de leurs programmes, de leurs enjeux, de leurs idéologies (Gaxie, 1998, dans Le cens caché).
M. K. : Cette difficulté à saisir les enjeux, à comprendre les dossiers et toutes les stratégies permettant de faire croire à l’inéluctabilité de certains choix, me fait affirmer qu’il manque à plusieurs niveaux une formation des citoyens. Daniel Gaxie a montré la forte liaison qui existe entre l’intérêt pour la politique et la durée de scolarisation. La compétence politique s’acquiert " indirectement " par le système scolaire : c’est la progressive acquisition des instruments linguistiques et conceptuels qui autorise l’acquisition de la compétence politique, même si le milieu familial joue également un rôle, stimulant ou étouffant. Le rôle des organisations politiques (partis, syndicats,…) est également primordial dans l’acquisition de compétences, mais aussi — et c’est parfois plus important encore — dans l’atténuation du sentiment d’incompétence politique. Dans cette perspective, pour développer la compétence politique dans tous les milieux sociaux et pour lutter contre les " inégalités de politisation ", Daniel Gaxie prône clairement l’introduction dans les programmes scolaires d’un " enseignement politique " et le développement de formations à la politique : pas seulement de timides et vagues sensibilisations au civisme, mais un véritable présentation des forces politiques, de leurs programmes, de leurs enjeux, de leurs idéologies (Gaxie, 1998, dans Le cens caché).
Cette introduction dans les programmes scolaires me paraît être un préalable indispensable à une familiarisation avec la politique, à sa dédramatisation mais aussi au développement de l’intérêt pour la politique. Elle devrait se faire dès le collège. Sensibiliser à la politique, c’est aussi sensibiliser aux sciences économiques et sociales (SES), qui sont les grandes absentes de la formation scolaire actuelle. Pire : la seule filière qui contenait ces thématiques dans ses programmes (la filière Économique et Sociale (ES), anciennement " filière B ") subit depuis la fin des années 90 les assauts répétés des gouvernements successifs. Après avoir supprimé Bourdieu du programme des SES en 2003, le projet de loi d’orientation en 2004 a pour conséquence de reléguer les SES au rang d’option facultative et tente de faire passer cet enseignement de culture générale au rang d’enseignement de gestion et de droit à seule visée professionnelle. Il faudrait au contraire développer les sciences économiques et sociales, en y ajoutant une formation politique (comme c’est déjà le cas en 1ère ES avec l’option " sciences politiques "), et les généraliser à l’ensemble des filières existantes.
De plus, des formations locales devraient pouvoir permettre à n’importe quel citoyen, quel que soit son âge et son niveau d’instruction, de se former à l’analyse des politiques publiques et à leur gestion politique, à la connaissance des collectivités territoriales et des institutions publiques, à l’analyse de programmes électoraux et d’idéologies politiques, à la prise de parole en public, etc., c'est-à-dire à l’acquisition d’une compétence politique lui permettant soit de contrôler les élus locaux, soit de s’engager plus avant en politique et d’y faire entendre sa voix. De telles formations existent au sein des formations partisanes ou même d’organismes privés. Il faudrait les rendre publiques, gratuites et indépendantes des partis politiques.
![]() R.B. : Concernant la formation de tous à la politique, je suis tout à fait d'accord : une véritable démocratie ne se limite pas à la généralisation du droit de vote, mais passe avant tout par la généralisation de la capacité à voter.
R.B. : Concernant la formation de tous à la politique, je suis tout à fait d'accord : une véritable démocratie ne se limite pas à la généralisation du droit de vote, mais passe avant tout par la généralisation de la capacité à voter.
Mais, espérer que chaque citoyen se verra accorder les moyens d'avoir accès au politique (ou à la culture ou à la connaissance) me paraît assez utopique dans une société qui n'est même pas en mesure d'assurer des droits fondamentaux comme l'accès à la santé, l'accès au logement ou l'accès au travail...
Le grand mérite du travail de M. Koebel est de montrer à quel point la proximité géographique n'est rien face à la proximité sociale, pour autant le constat me paraît un peu trop pessimiste :
- la décentralisation et son corollaire la déconcentration ont conduit à multiplier les intervenants (ministère, préfecture, Région, Département, structure intercommunale, commune, associations...) et les décisionnaires sur tous les domaines de l'activité publique. Alors bien sûr, ces intervenants ont tous à peu près les mêmes caractéristiques sociales et aucun ne représente vraiment les intérêts des dominés. Pour autant, chacun doit entrer en compétition avec les autres pour défendre son territoire et ses prérogatives. Je pars du principe que, finalement, la lutte entre les dominants offre des marges de manœuvre inespérées aux dominés. Marge de manœuvre que le préfet d'avant la décentralisation, véritable seigneur de la République, n'offrait pas.
![]() M.K. : Croire que la concurrence entre dominants profite aux dominés, n’est-ce pas avoir une vision néo-libérale du progrès ? Je répète une nouvelle fois les propos de Bourdieu : « c’est en servant leurs propres intérêts que les hommes politiques servent le mieux ceux de leurs mandants ». Mais sur combien de dossiers l’intérêt des dominants rejoint-il l’intérêt des dominés ? Est-ce que la concurrence entre grands groupes commerciaux améliore la nourriture la moins chère, celle que la majorité des consommateurs, faute de moyens économiques, est obligée d’accepter comme alimentation de base ? Même analyse pour la concurrence entre chaînes de télévision, etc.
M.K. : Croire que la concurrence entre dominants profite aux dominés, n’est-ce pas avoir une vision néo-libérale du progrès ? Je répète une nouvelle fois les propos de Bourdieu : « c’est en servant leurs propres intérêts que les hommes politiques servent le mieux ceux de leurs mandants ». Mais sur combien de dossiers l’intérêt des dominants rejoint-il l’intérêt des dominés ? Est-ce que la concurrence entre grands groupes commerciaux améliore la nourriture la moins chère, celle que la majorité des consommateurs, faute de moyens économiques, est obligée d’accepter comme alimentation de base ? Même analyse pour la concurrence entre chaînes de télévision, etc.
![]() R.B. : Concernant la concurrence entre dominants, je disais que cela pouvait créer des " marges de manœuvre " pour les dominés, je ne parlais pas de mécanismes conduisant inéluctablement à l'optimum social (version néo-libérale) ou à la victoire du prolétariat (version marxiste).
R.B. : Concernant la concurrence entre dominants, je disais que cela pouvait créer des " marges de manœuvre " pour les dominés, je ne parlais pas de mécanismes conduisant inéluctablement à l'optimum social (version néo-libérale) ou à la victoire du prolétariat (version marxiste).
Même s'il n'y a pas de " Sens de l'Histoire ", cela ne veut pas dire que le présent est inéluctable et indépassable. L'ordre établi, malgré les moyens qu'il déploie pour se pérenniser et se naturaliser, n'est qu'une construction sociale et historique, qui, en tant que tel, évolue sans cesse sous l'effet des jeux et des luttes de pouvoirs.
Peut-être que l'utilisation du terme de " concurrence " a pu créer un malentendu. Mais quand, quelques phrases après avoir dénoncé ma vision néo-libérale, M. Koebel en vient à dire exactement la même chose que moi et à regretter que les Villes et l'État ne rentrent plus en concurrence pour le financement des MJC et que cela empêche toute stratégie de contournement et donc limite les marges de manœuvre des MJC..., on reste alors, pour le moins, perplexe...
![]() M.K. : Pour revenir à l’espace local : le recours à des entreprises privées, dans un souci d’économie de moyens, pour la confection des repas dans les cantines scolaires ou pour l’entretien des écoles a-t-il amélioré la qualité des services correspondants ? Posons la question aux directeurs d’école, aux enfants, et analysons la qualité de la nourriture, analysons le nombre d’emplois locaux sacrifiés. Là, évidemment, je n’ai pas fait d’études poussées sur la question (et je n’en connais pas), je n’ai que mon expérience de délégué de parents d’élèves.
M.K. : Pour revenir à l’espace local : le recours à des entreprises privées, dans un souci d’économie de moyens, pour la confection des repas dans les cantines scolaires ou pour l’entretien des écoles a-t-il amélioré la qualité des services correspondants ? Posons la question aux directeurs d’école, aux enfants, et analysons la qualité de la nourriture, analysons le nombre d’emplois locaux sacrifiés. Là, évidemment, je n’ai pas fait d’études poussées sur la question (et je n’en connais pas), je n’ai que mon expérience de délégué de parents d’élèves.
![]() R.B. : Je trouve que les services publics se sont plutôt bien accommodés de la décentralisation, les collectivités locales investissent et embauchent nettement plus que l'État et, malgré les disparités locales, si les collectivités les plus riches ont pu aller plus loin, les collectivités les plus pauvres n'ont pas connu de recul significatif des services publics transférés. Il me semble que la proximité géographique, même si elle n'est pas synonyme de proximité d'intérêts, rend plus concrète et donc plus difficile la casse des services publics. Combien d'élus, en tant que députés ou sénateurs, votent la baisse des budgets de santé ou le gel des postes à l'Éducation nationale, mais de retour chez eux, en tant qu'élus locaux, défilent en tête des cortèges pour défendre la maternité de leur hôpital ou pour protester contre la fermeture d'une classe dans leur école ? Ils sont rares, mais il y en a. Cet attachement soudain aux services publics cache peut être des tendances au clientélisme ou à l'électoralisme. Il n'empêche, en bon pragmatiste, je préfère les néo-libéraux convaincus qui sont contraints par les " réalités du terrain " à défendre les services publics aux socio-démocrates convaincants qui bradent tous leurs idéaux au nom des réalités économiques !!!!
R.B. : Je trouve que les services publics se sont plutôt bien accommodés de la décentralisation, les collectivités locales investissent et embauchent nettement plus que l'État et, malgré les disparités locales, si les collectivités les plus riches ont pu aller plus loin, les collectivités les plus pauvres n'ont pas connu de recul significatif des services publics transférés. Il me semble que la proximité géographique, même si elle n'est pas synonyme de proximité d'intérêts, rend plus concrète et donc plus difficile la casse des services publics. Combien d'élus, en tant que députés ou sénateurs, votent la baisse des budgets de santé ou le gel des postes à l'Éducation nationale, mais de retour chez eux, en tant qu'élus locaux, défilent en tête des cortèges pour défendre la maternité de leur hôpital ou pour protester contre la fermeture d'une classe dans leur école ? Ils sont rares, mais il y en a. Cet attachement soudain aux services publics cache peut être des tendances au clientélisme ou à l'électoralisme. Il n'empêche, en bon pragmatiste, je préfère les néo-libéraux convaincus qui sont contraints par les " réalités du terrain " à défendre les services publics aux socio-démocrates convaincants qui bradent tous leurs idéaux au nom des réalités économiques !!!!
![]() M.K. : Il est vrai que l’on a pu voir des élus s’engager dans un processus de lutte locale contre des logiques néo-libérales (villes hors AGCS, villes d’ATTAC, communes de la Creuse qui ont défendu les services publics…). Il est vrai que certains services ont pu être améliorés par la décentralisation. N’oublions pas non plus, a contrario, que l’augmentation du pouvoir des élus locaux au détriment des interventions de l’État (qui, sur le plan géographique, était, je le rappelle, tout de même présent à l’échelle départementale — et même parfois infra-départementale — à travers les services extérieurs de l’État) provoque une plus grande dépendance des associations locales au bon vouloir (et aux options idéologiques) des seuls élus locaux. C’est particulièrement le cas des associations œuvrant dans le domaine social et culturel, qui ont du mal à survivre sans les subventions. Lorsque l’État était encore un acteur local influent, il pouvait compenser l’absence d’investissement d’une collectivité appliquant des critères inavouables — parce que politiques ou idéologiques — pour refuser son soutien. L’une des raisons qui explique que les centres socio-culturels et les MJC sont de moins en moins des lieux de contre-pouvoir ou de formation politique (comme ils ont pu l’être à une autre époque), est qu’ils sont de plus en plus dépendants du seul pouvoir local. La politique de l’État en matière d’attribution financière — quand cette politique existe encore localement comme dans la politique de la ville — nécessite de plus en plus un financement local comme condition nécessaire au financement de l’État, ce qui a pour effet d’annihiler un possible contre-financement. Cela provoque des effets concrets d’étouffement d’initiatives citoyennes, tant l’angoisse de perdre ses financements dans un contexte difficile est grande.
M.K. : Il est vrai que l’on a pu voir des élus s’engager dans un processus de lutte locale contre des logiques néo-libérales (villes hors AGCS, villes d’ATTAC, communes de la Creuse qui ont défendu les services publics…). Il est vrai que certains services ont pu être améliorés par la décentralisation. N’oublions pas non plus, a contrario, que l’augmentation du pouvoir des élus locaux au détriment des interventions de l’État (qui, sur le plan géographique, était, je le rappelle, tout de même présent à l’échelle départementale — et même parfois infra-départementale — à travers les services extérieurs de l’État) provoque une plus grande dépendance des associations locales au bon vouloir (et aux options idéologiques) des seuls élus locaux. C’est particulièrement le cas des associations œuvrant dans le domaine social et culturel, qui ont du mal à survivre sans les subventions. Lorsque l’État était encore un acteur local influent, il pouvait compenser l’absence d’investissement d’une collectivité appliquant des critères inavouables — parce que politiques ou idéologiques — pour refuser son soutien. L’une des raisons qui explique que les centres socio-culturels et les MJC sont de moins en moins des lieux de contre-pouvoir ou de formation politique (comme ils ont pu l’être à une autre époque), est qu’ils sont de plus en plus dépendants du seul pouvoir local. La politique de l’État en matière d’attribution financière — quand cette politique existe encore localement comme dans la politique de la ville — nécessite de plus en plus un financement local comme condition nécessaire au financement de l’État, ce qui a pour effet d’annihiler un possible contre-financement. Cela provoque des effets concrets d’étouffement d’initiatives citoyennes, tant l’angoisse de perdre ses financements dans un contexte difficile est grande.
![]() R.B. : Concernant la gestion du service public par les collectivités locales, je suis bien d'accord pour dire que ce qui est fait est très insuffisant, mais n'oublions pas le contexte national que nous connaissons depuis 20 ans : déréglementation, libéralisation, privatisations larvées ou carrément assumées, gestion des services publics calquée sur la gestion des entreprises privées, pénurie de postes, de moyens et de perspectives... Désolé, mais quand je vois l'état de délabrement des secteurs gérés à 100 % par l'Etat (justice, système pénitentiaire, hôpitaux, recherche scientifique...), je me dis que la décentralisation n'a pas un si mauvais bilan, même s'il pourrait être bien meilleur...
R.B. : Concernant la gestion du service public par les collectivités locales, je suis bien d'accord pour dire que ce qui est fait est très insuffisant, mais n'oublions pas le contexte national que nous connaissons depuis 20 ans : déréglementation, libéralisation, privatisations larvées ou carrément assumées, gestion des services publics calquée sur la gestion des entreprises privées, pénurie de postes, de moyens et de perspectives... Désolé, mais quand je vois l'état de délabrement des secteurs gérés à 100 % par l'Etat (justice, système pénitentiaire, hôpitaux, recherche scientifique...), je me dis que la décentralisation n'a pas un si mauvais bilan, même s'il pourrait être bien meilleur...
![]() M.K. : Je finis par un exemple encore plus cocasse : pour diffuser les thèses que je développe dans mon ouvrage, j’ai sollicité de nombreuses librairies pour organiser des conférences-débats. Une grande librairie de Lille m’a fait comprendre, au bout de quelques semaines d’attente incompréhensible et malgré mes sollicitations multiples, qu’il serait malvenu d’accepter la venue d’un sociologue critique vis à vis du pouvoir local compte tenu du fait que la librairie dépendait en partie de subventions municipales. Un ami m’a même proposé de demander son autorisation à Martine Aubry…
M.K. : Je finis par un exemple encore plus cocasse : pour diffuser les thèses que je développe dans mon ouvrage, j’ai sollicité de nombreuses librairies pour organiser des conférences-débats. Une grande librairie de Lille m’a fait comprendre, au bout de quelques semaines d’attente incompréhensible et malgré mes sollicitations multiples, qu’il serait malvenu d’accepter la venue d’un sociologue critique vis à vis du pouvoir local compte tenu du fait que la librairie dépendait en partie de subventions municipales. Un ami m’a même proposé de demander son autorisation à Martine Aubry…