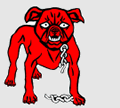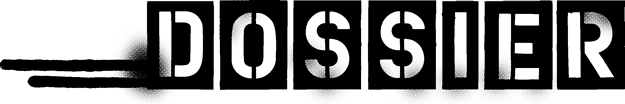
CQFD, n°3, juillet 2003.
![]() Olivier Cyran : Appel général à la désertion
Olivier Cyran : Appel général à la désertion
![]() Radiations et contes de fées à l'ANPE de Paris 12
Radiations et contes de fées à l'ANPE de Paris 12
ANNEXES :
- entretien avec Jeanne
- entretien avec Hervé
APPEL GÉNÉRAL À LA DÉSERTION
Avec l’énergie du moribond, les gouvernants s’emploient à « revaloriser » le travail. Au besoin, par la force. Mais de plus en plus d’actifs ont compris que pour valoriser leur boulot, ils fallaient d’abord qu’ils s’en passent. Et qu’ils se débarrassent aussi du mode de consommation qui va avec. Pas facile, mais pas triste. Panorama d’une désertion appelée à s’étendre.
Le tripalium (instrument de torture, source éthymologique du mot « travail ») est excellent pour la santé. Comme cette vérité n’est pas toujours bien présente à l’esprit des suppliciés, il faut la leur enfoncer dans le crâne par décret ministériel. D’où l’initiative prise en décembre dernier par le Premier ministre de commander au Conseil économique et social — un boudoir rempli de rentiers plus ou moins somnolents — une étude visant à « revaloriser le travail ». Le salariat souffrirait d’une « dépréciation » dommageable à la corvéabilité du personnel, s’alarme Matignon, qui souhaite « explorer les voies et moyens propres à mieux valoriser la fonction sociale du travail dans le développement du progrès individuel et collectif »
Aidons-le à explorer. Explorons avec ceux qui ont fait le voyage et en sont revenus, déserteurs du travail, refuzniks du métro-boulot-conso, réfractaires aux échelles pleines de barreaux, d’échardes et de fissures qui mènent au « progrès ». Badi a la trentaine. Originaire de la Grande Borne, une cité de l’Essonne qui émarge chaque année au tableau médiatique des « violences urbaines », ce fils d’immigrés n’a jamais glandé dans un groupe militant libertoïde. C’est en solitaire, guidé seulement par sa répugnance naturelle des codes hiérarchiques, que Badi a emprunté le chemin qui l’a amené en 1999 à refuser le travail. « Je suis un gosse de la laïque, explique-t-il. On m’a toujours appris à bien faire mon travail. Je n’ai pas besoin qu’un chef me le répète. Alors, pour me débarrasser des chefs, je me suis débarrassé du travail ». Son RMI lui permet tout juste de payer le loyer de son studio et de faire le plein de pâtes alimentaires : « De toutes façons je sors peu, je bois pas et quand j’ai envie d’écouter l’un de mes cinq ou six disques, ma voisine me prête son lecteur de CD ». Trois années de charité esclavageuse à l’Armée du Salut et quelques corvées intérimaires ont suffi à l’éclairer sur la nature intrinsèquement névrotique du monde du travail : « C’est comme le mythe de Sisyphe. L’histoire du gars qui s’emmerde à pousser la pierre, qui pousse et qui pousse, et quand il arrive en haut de la montagne, la pierre dégringole et il recommence depuis le début. Ceux qui refusent ce jeu sont en général les malins qui, postés sur le bord du sentier, brandissent le fouet pour que tu pousses plus vite. Moi, je refuse les deux : la pierre et le fouet. »
La pierre ou le fouet : l’alternative insupporte de plus en plus franchement les « actifs » pour qui l’activité se conçoit autrement que comme une soumission à la pointeuse. On sait aujourd’hui les ravages que l’ordre hiérarchique inhérent à l’organisation du travail inflige à la santé publique (dépressions, stress, alcoolisme...). Au même titre que le tabac, le travail tue : deux millions de morts par an dans le monde, selon le Bureau international du travail. Mais la désintoxication n’est toujours pas remboursée par la Sécu. On dit que le travail structure l’individu. Mais la structure s’effrite avant l’âge : « Les ouvriers du BTP subissent une usure prématurée accompagnée de douleurs articulaires, les manutentionnaires souffrent de graves tendinites, certains travailleurs manuels sont cassés à 40 ans », observait en mai dernier l’association de la médecine du travail (Ametra). La vie de bureau ne vaut pas mieux. Triomphe du pervers polymorphe, management par la peur, sadisme au quotidien : les violences qui s’y exercent ont fait l’objet d’un best-seller (1) dont le succès (officialisé par une loi peu opérante contre le harcèlement moral – comme si on pouvait s’attaquer au cancer sans s’attaquer aux cancérigènes) démontre la vétusté du culte voué au travail.
Certes, les clichés ont la vie dure. L’idée reçue, par exemple, selon laquelle un salarié n’est jamais aussi performant que lorsqu’il est « bien dans sa peau ». Une étude menée il y a trois ans par deux scientifiques canadiens a tordu le cou à cette vieille lune. Robert Sinclair et Carrie Levis, psychologues à l’Université d’Alberta, ont longuement étudié le comportement des salariés d’une entreprise d’équipements électroniques. De leurs travaux, il ressort que le salarié maussade ou dépressif est deux fois plus productif que le collègue souriant ou heureux. Efficacité au labeur et joie de vivre seraient donc incompatibles. Un salarié de la cadavérique « nouvelle économie » en a fait l’expérience, embauché en février 2000 par le site lanetro.fr et licencié un an plus tard pour faute lourde : il avait éclaté de rire au bureau.
L’idée que le travail n’est pas une valeur forcément inhérente à la condition humaine, et moins encore son but suprême, est bien plus ancienne que le capitalisme moderne. Elle fut avancée dès la fin du XVIIIe siècle par Thomas Paine, journaliste américain devenu citoyen français et député à la Convention. Considérant que l’appropriation de la terre par les nobles justifiait l’octroi aux masses des moyens de subsister, Thomas Paine fut l’un des premiers à en déduire la nécessité de créer un revenu d’existence indépendant du travail. C’était, deux siècles avant Rocard, une idée autrement plus généreuse que la caricature qu’en donne le RMI, rabais « d’insertion » dont le but explicite est que la force de travail ne crève pas de faim avant son retour à la case exploitation. La « réforme » cuisinée par le gouvernement Raffarin (le RMA, ou le turbin obligatoire pour les oisifs, qui se verraient astreints à des petits travaux précaires dans le privé) ne fait que pousser cette logique plus avant. Pas question, en effet, que le RMI serve de prime à la paresse : pour preuve, la radiation des Rmistes qui, ne souhaitant pas « s’insérer » entre le marteau et l’enclume, se voient traîner devant le jury du « comité local d’insertion ». C’est ce qu’on appelle le contrôle social, une invention « structurante » à laquelle il est parfois plus difficile d’échapper que le travail. Dans l’esprit de Thomas Paine, il s’agissait de donner à manger aux pauvres — mais au moins leur faisait-il grâce du chantage à l’« insertion ».
Depuis Paine, l’idée que les richesses d’une collectivité pouvaient être partagées autrement qu’au détriment de ceux qui travaillent et qu’au profit de ceux qui amassent a fait son chemin. Ils sont aujourd’hui un bon nombre à estimer que la capacité productive d’une société est le patrimoine de tous, non la propriété d’une poignée d’actionnaires, et qu’en conséquence ses fruits doivent profiter à l’ensemble des citoyens, qu’ils bossent ou non. Ce courant est né de la prise de conscience que la folie productiviste envoyait l’humanité dans le mur. À quoi bon disposer de cinquante marques de voitures, de consoles ou de compotes ? À quoi bon créer des besoins artificiels dont la satisfaction va causer toujours plus d’ahurissement, de laideur et de toxines ? Il est regrettable, d’ailleurs, que la question du gaspillage – des ressources comme des travailleurs – fut à ce point absente de la bagarre sur les retraites, alors que « l’horizon 2040 » dont nous envoûte le pouvoir donnait enfin l’opportunité de se projeter dans le long terme. Et de prendre acte que le maintien du pouvoir d’achat – revendiqué à juste raison quand c’est les plus riches qui le grignotent sur le dos des plus modestes – a pour conséquence le pillage du tiers-monde, l’encrassage de la planète et la famine de millions d’individus, qui partent à la retraite pieds devant.
Spectaculaire régression. Accrochée au dogme de la « croissance » comme un furoncle au fessier du baron Seillière, la gauche a oublié les temps anciens, au début des années 70, quand la Kommandantur actionnariale n’avait pas encore statut de monarchie absolue. Quelques doux rêveurs préconisaient alors d’éradiquer toutes les tâches inutiles, néfastes ou antisociales qui, selon André Gorz, composent 90 % des emplois de la sphère capitaliste (2). C’est l’utopie de la fin du travail : on verserait un revenu d’existence à tous en échange du peu de travail social qui resterait à effectuer, et dont la nature et l’ampleur serait décidées collectivement. En anarchiste doux et poète concret, Gébé lançait dans L’An 01 : « On s’arrête tous, on fait un pas de côté, on réfléchit et c’est pas triste ! ».
Certains se sont arrêtés, en effet. Ont expérimenté l’autogestion. Elevé des chèvres au Larzac. Joué aux chercheurs d’or dans le Gard. Créé des maisons d’édition où le salariat est proscrit. Inventé des modes de vie, ouvert des espaces, exploré des bifurcations. Et après ? « L’utopie était jouable, plaide Gébé. Aujourd’hui, on en est réduits à se battre pour des causes qui, à l’époque, nous paraissaient totalement dépassées : que les patrons y mettent les formes pour dégraisser, alors que nous ne voulions plus de patrons, que les détenus aient le droit de ne pas se retrouver pendus, alors que nous ne voulions plus de prisons, que les bagnoles consomment un peu moins, alors que nous ne voulions plus de bagnoles. »
C’est qu’entretemps a eu lieu la contre-offensive des père-fouettards en attaché-case. L’augmentation simultanée, sous le règne des socialistes, du chômage et des profits, a tôt fait de ravaler les espoirs investis dans le dépassement de la pierre et du fouet. La fin du travail se réalisait au pied de la lettre : par des licenciements massifs. Ce n’était plus les travailleurs qui s’émancipaient des chaînes de production, c’étaient les employeurs qui les viraient pour engrosser leurs marges. Face à la déglingue des salariés jetables, la revendication du droit à la paresse semblait décalée, irresponsable. D’autant que les libéraux, toujours prompts à s’emparer des idées de leurs ennemis, avaient aussitôt récupéré celle du revenu d’existence. Argument servi par l’économiste escroc Friedman : puisqu’on ne saurait donner du travail à chacun, entérinons la division de la société en deux classes – productives et non-productives – et versons aux superflus les miettes vitales qui préserveront notre train de vie. Un minimum universel, flanqué d’un maximum carcéral pour ceux qui ne s’en contenteraient pas...
Il y aurait bien un remède à l’affection dévorante des capitalistes pour le revenu d’existence : chiffrer celui-ci à un niveau de rémunération suffisamment conséquent pour que le salariat perde de son attrait. Des lugubres bien intentionnés fustigent régulièrement l’effet prétendument « désincitatif » des minima sociaux sur les demandeurs d’emploi : le peu qu’on leur donne, c’est déjà trop, car ça les décourage d’aller postuler chez McDo. On ne s’étonnera donc pas que la plupart des économistes « de gauche » favorables au revenu d’existence tricotent celui-ci à 1 500 ou 2 000 balles par mois. Au-delà, disent-ils, ça déprimerait les forces vives. Il est vrai qu’avec un revenu d’existence fixé à un seuil raisonnable et versé sans conditions, l’effet désincitatif changerait de camp : les patrons seraient dissuadés de recruter au rabais. Halte là, Toto, tu rêves ? Et pendant que le débat s’embourbe mollement dans les ornières du marché, la pensée du même nom poursuit vigoureusement son programme : « inciter au travail ». Avec le Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE), bientôt suivi du RMA, le chômeur n’est plus en débrouillard en roue libre, mais un battant payé à effectuer une « recherche dynamique d’emploi ». Pour, en bout de course, servir de supplétif à l’employeur croulant sous les primes et libéré de charges sur les bas salaires…
Dans ces conditions, se mettre hors du coup exige une sacrée force de caractère. Jeanne, 52 ans, chômeuse délibérée depuis dix ans, en a plus qu’il n’en faut : « Je ne serai plus jamais un petit toutou auquel on file le SMIC pour qu’il la ferme », jure cette ancienne ouvrière aujourd’hui « heureuse », mais en cours de radiation. Pas facile, cependant, d’ériger cette rupture en modèle. « C’est important de se sentir utile, remarque Hervé, chômeur marseillais et libertaire impénitent, filmé dans Attention Danger Travail. On ne peut choisir d’être chômeur que si on a une idée claire du contenu que l’on veut donner à sa vie. Mais la plupart n’ont pas les moyens de choisir. »
N’empêche. Quelles que soient les impasses pratiques ou théoriques où s’engouffrent les allergiques au salariat, aussi modeste que puisse être un choix voué le plus souvent à rester individuel, il n’en demeure pas moins que c’est parmi les fous qui « volem rien foutre al païs » que l’on trouve la meilleure part de lucidité, de rébellion et, finalement, de cohérence. Comme dit Jeanne : « Le travail, c’est comme la guerre : et si personne n’y allait ? ». Après tout, dans les guerres non plus, les déserteurs n’attendent pas que toute la soldatesque dépose les armes pour faire un bras d’honneur aux galonnés.
Olivier Cyran
(1) Le harcèlement moral, par Marie-France Hirigoyen (Syros, 1998).
(2) Sur cette estimation, lire Misères du présent, richesse du possible, André Gorz (Galilée, 1997)